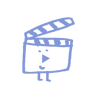En 2015, les trois principaux théâtres d’Oslo ont accueilli 56000 spectateurs de plus que lors de l’année précédente. Cette curiosité du public norvégien répond à l’extraordinaire créativité d’une nouvelle génération d’auteurs. La plupart sont encore peu connus en France1, même si certains d’entre eux, tels que Jon Fosse ou Arne Lygre, sont aujourd’hui au premier rang de la dramaturgie mondiale.
Né à Bergen en 1968, auteur de romans et de nouvelles, Arne Lygre écrit pour le théâtre depuis 1998. Dès ses premières pièces (il en a publié huit à ce jour), il se fait connaître hors des frontières de la Scandinavie. Traduites dans une douzaine de langues, elles sont jouées au Danemark, en Estonie, en Italie, au Portugal, au Brésil, en Allemagne. En France, un premier texte dramatique est traduit en 2000 par Terje Sinding. Mais sa véritable notoriété date des mises en scène de Claude Régy (qui crée Homme sans but à l’Odéon en 2006) et de Stéphane Braunschweig, qui nourrit pour l’écriture de Lygre une véritable passion. Dès 2011, le directeur du Théâtre national de la Colline met en scène Je disparais dans une traduction d’Eloi Recoing et décide de faire connaître Lygre au public le plus large en programmant son œuvre non dans le Petit Théâtre, mais pendant plus d’un mois dans la Grande Salle. À cette occasion, il invite aussi l’auteur à venir en France pour une rencontre avec les spectateurs au cours d’une soirée exceptionnelle, et la revue OutreScène2 consacre à Arne Lygre un important numéro comprenant des entretiens, des études ainsi que trois textes inédits. Un an plus tard, Braunschweig crée Tage unter (Jours souterrains) en langue allemande à Berlin et Düsseldorf avant de présenter à Paris sa mise en scène surtitrée. Enfin, en 2014, il traduit lui-même Rien de moi avec la collaboration de la dramaturge Astrid Schenka et en dirige la création française, toujours au Théâtre de la Colline.
Lygre partage avec d’autres auteurs du nord de l’Europe du nord certains traits caractéristiques, sans doute puisés dans l’héritage ibsénien : l’intérêt pour les relations entre proches (notamment au sein d’une famille) ; le goût des silences et des secrets intimes ; l’intensité énigmatique d’un laconisme n’excluant pas un certain goût du jeu ; un sens aigu des contradictions de la psyché ; une façon très particulière, à la fois discrète et frappante, de conduire en quelques répliques faussement banales au télescopage de différents plans d’énonciation ou d’existence, parfois jusqu’aux confins du fantastique.
Son œuvre explore de façon extrêmement personnelle les formes de la solitude et de l’aliénation contemporaines. Ses créatures semblent parfois chercher à fonder, à inventer, ou simplement rejoindre un monde nouveau. Ce peut être un appartement vide dans lequel on emménage (Rien de moi) ; ou encore, une ville inouïe bâtie à partir de rien sur une terre vierge, comme dans un conte (Homme sans but) ; ou enfin, plus simplement, une rencontre de hasard sur un quai nocturne, comme en marge de la vie ordinaire – une explosion de désir qui se croit entre parenthèses (Pour un moment). L’existence y serait enfin portée à un degré supérieur de puissance et de présence : l’amour y trouverait sa demeure intime, ou le travail humain, le territoire depuis lequel se transcender ; accomplissant une utopie informulée, histoire et liberté trouveraient enfin à s’y réconcilier. Mais cela ne dure pas. Si cette invention d’un monde peut être légère et ludique, elle peut aussi se charger de menace, voire de terreur. Car elle se laisse tantôt décrire comme la conquête d’un espace neuf ouvert à la liberté des êtres, tantôt comme une isolation, voire une séquestration à l’écart de la réalité commune (Jours souterrains).
L’écriture de Lygre paraît donc hantée par ce qu’on pourrait appeler son intuition de la fragilité des frontières : une certaine forme de spatialité (de trouble temporel, aussi) qui n’appartient qu’à lui, et qui contribue sans doute à conférer à ses pièces leur force théâtrale si particulière. Tantôt franchies, tantôt refermées, ces frontières ne sont chez lui jamais parfaites, toujours marquées d’une légère incertitude. Les paysages dramatiques qu’elles définissent ne sont que suggérés en quelques touches qu’il appartient au public de compléter en imagination.
Cette précarité des limites se retrouve au cœur des présences qui habitent la scène. Le moi selon Lygre est en quelque sorte poreux. Il l’est d’abord en lui-même. La conscience et l’inconscient, l’identité réelle et ses projections fictives ou fantasmatiques, les différentes profondeurs du temps peuvent à tout moment déraper l’un sur l’autre. Et il arrive que les limites entre personnages ne soient pas moins incertaines. Même les pronoms peuvent subtilement changer d’emploi, même les styles direct et indirect, l’adresse et le récit, peuvent superposer leurs registres. Les êtres humains que crée Lygre sont d’ailleurs souvent anonymes, comme si un nom était déjà un excès de définition, risquait de trop fixer leur(s) personnalité(s). Ce n’est pas qu’ils en soient dépourvus, mais elle se présente, selon les moments, sous des formes plus ou moins concentrées. Comme si la consistance des êtres ne se laissait pas séparer de la parole qui les affirme et en quelque sorte les renégocie, instant après instant (chez Lygre, le récit semble souvent constitutif des sujets et des événements, qu’il produit autant qu’il les rapporte). Ou comme si chacun, face à autrui, risquait à tout moment d’être traversé par des fantômes surgis de partout, hanté par l’autre aussi bien que par soi. Aux yeux du dramaturge, note Stéphane Braunschweig, « le rapport à l’autre », toujours mouvant, devient ainsi source d’angoisse, « tant par la menace que l’autre constitue pour l’autonomie du Moi, que par le danger que l’on constitue soi-même pour l’autre ». D’un autre côté, cependant, l’établissement de frontières trop fermes et définitives suscite à son tour « une terreur spécifique liée à la fixation de l’identité, ou à la façon dont l’autre vous fixe dans une image, qui peut vous convenir un moment, mais seulement un moment… Pouvoir y échapper est salvateur, mais le besoin d’échapper à la solitude n’est pas moindre : tragique contradiction. »
Cette dialectique du lien à l’autre, ce paradoxe de l’identité qui se noue et se débat dans ce lien, animent de part en part la dernière pièce d’Arne Lygre : Pour un moment, que Stéphane Braunschweig met en lecture deux ans après la création de Rien de moi. À nouveau traducteur, il a choisi d’en transposer le titre (effectivement intraduisible) : La deg være. Littéralement, ces mots signifieraient quelque chose comme “Te laisser être” ou “Laisser que tu sois”. Cette injonction à “laisser être” l’autre est explorée à travers une chaîne non pas tant de personnages que de figures – voire, si l’on peut dire, de “rôles relationnels”. Pour ses lecteurs, Lygre les désigne sobrement comme étant “une personne”, “un-e ami-e”, une « connaissance », “un-e inconnu-e”, “un-e ennemi-e”. Pour ses spectateurs, c’est une autre affaire : en l’absence d’indices explicites, ces différentes catégories ne se laissent cerner que peu à peu au fil de la représentation. Cette identification progressive et comme en filigrane des êtres présentés en scène, par le biais des relations qu’ils entretiennent (et parfois redéfinissent, car ces rôles, remarque le metteur en scène, « sont aussi comme des destins à assumer ou contourner »), constitue certainement l’un des ressorts secrets qui confèrent à Pour un moment son étrange tension dramatique.
De fait, les figures se succèdent en scène selon un ordre aussi précis qu’il est imperceptible au premier abord. Les deux “personnes”, trois “ami-e-s”, quatre “connaissances”, cinq “inconnu-e- s” et six “ennemi-e-s” (soit au total une vingtaine de personnages) forment plusieurs constellations humaines occupant chacune un certain épisode théâtral. Tout le développement de Pour un moment naît du passage contrasté de l’une de ces constellations à la suivante. Il y en a six en tout, disposées de la plus complexe (où tous les rôles relationnels sont présents) à la plus simple (où il n’en reste plus qu’un). Tout au long de la pièce, deux constellations successives partagent toujours au moins un “rôle” (et non un personnage !) commun, lequel est mis en relief par l’auteur avant d’être retiré du jeu. Ainsi, les deux premiers épisodes comprennent deux “personnes”, puis la position de “personne” est éliminée ; les deuxième et troisième contiennent deux “amis” distincts, avant que la fonction amicale soit supprimée ; les troisième et quatrième font intervenir deux “connaissances”, qui sont ensuite abolies à leur tour, et ainsi de suite. Pour un moment s’ouvre donc sur la plus forte proximité affective (autour du lien personne-ami-e) et dérive par étapes vers une distance maximale (autour du rapport inconnu-e/ennemi-e… et au-delà). Comme par ailleurs les épisodes se suivent également par ordre décroissant de longueur, le rythme général de la pièce tient à la fois du compte à rebours et du mouvement accéléré, jusqu’à que soit rejoint un point d’ultime solitude.
L’action/narration, qui prend donc son élan initial dans le dialogue entre une femme et son amie, fixe assez rapidement ses premières unités de lieu et d’action : la nuit, un quai presque désert. Mais elle ne s’y attarde pas, car il se produit un événement imprévisible (qu’il serait dommage de dévoiler). L’intrigue en suit dès lors les répercussions de proche en proche, d’une constellation à l’autre, à la façon d’un galet faisant des ricochets à la surface des existences.
À la fois dit et vécu (voire dit au-delà même de la vie), l’ensemble fait songer à plusieurs plans-séquences contemplatifs et dramatiques. Contemplatifs par le détachement que semblent introduire les dialogues à demi distanciés ; dramatiques par l’acuité des événements, entremêlant désir et mort, qui se développent sous nos yeux dans la confrontation dynamique des identités et le flottement d’un pur présent théâtral. Le témoin que les personnages se passent au long de cette ronde (il n’est pas interdit de songer parfois à Schnitzler) ne cesse jamais de circuler. Parfois, il semble s’attarder chez l’un ou l’autre, mais l’illusion ne dure pas. Nous seuls, qui nous tenons à l’extérieur, pouvons tenir les deux bouts de leur chaîne – pareille à celle où tous les humains sont pris – et pressentir ce qui fait la secrète unité de leur communauté invisible – “pour un moment”.
Daniel Loayza
29 septembre 2016
1- On trouvera sur internet une présentation succincte (en langue anglaise) de 23 dramaturges norvégiens contemporains dans un ouvrage intitulé Norwegian Drama Now
2- OutreScène, La revue de la Colline, n°13 (novembre 2011).
Nouvelles dramaturgies européennes
Pour un moment » d'Arne Lygre
Lecture dirigée par Stéphane Braunschweig
Lundi 3 octobre 2016 / 20h
Odéon 6e / Grande Salle
Catégories : Le foyer : partager les idées